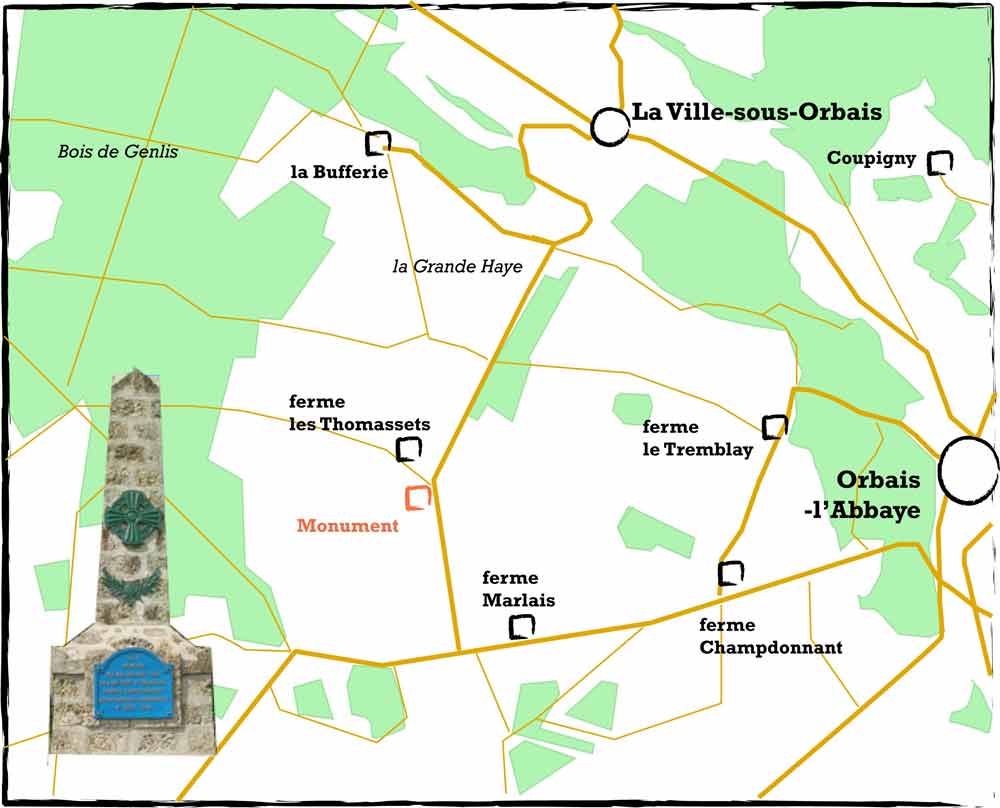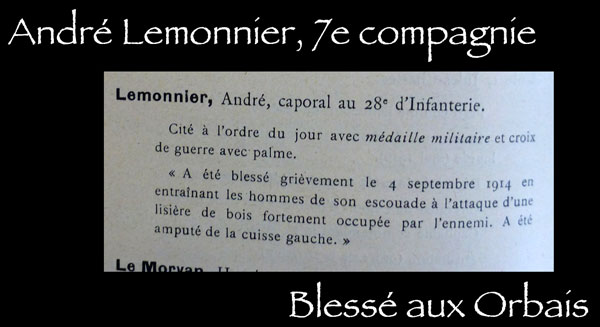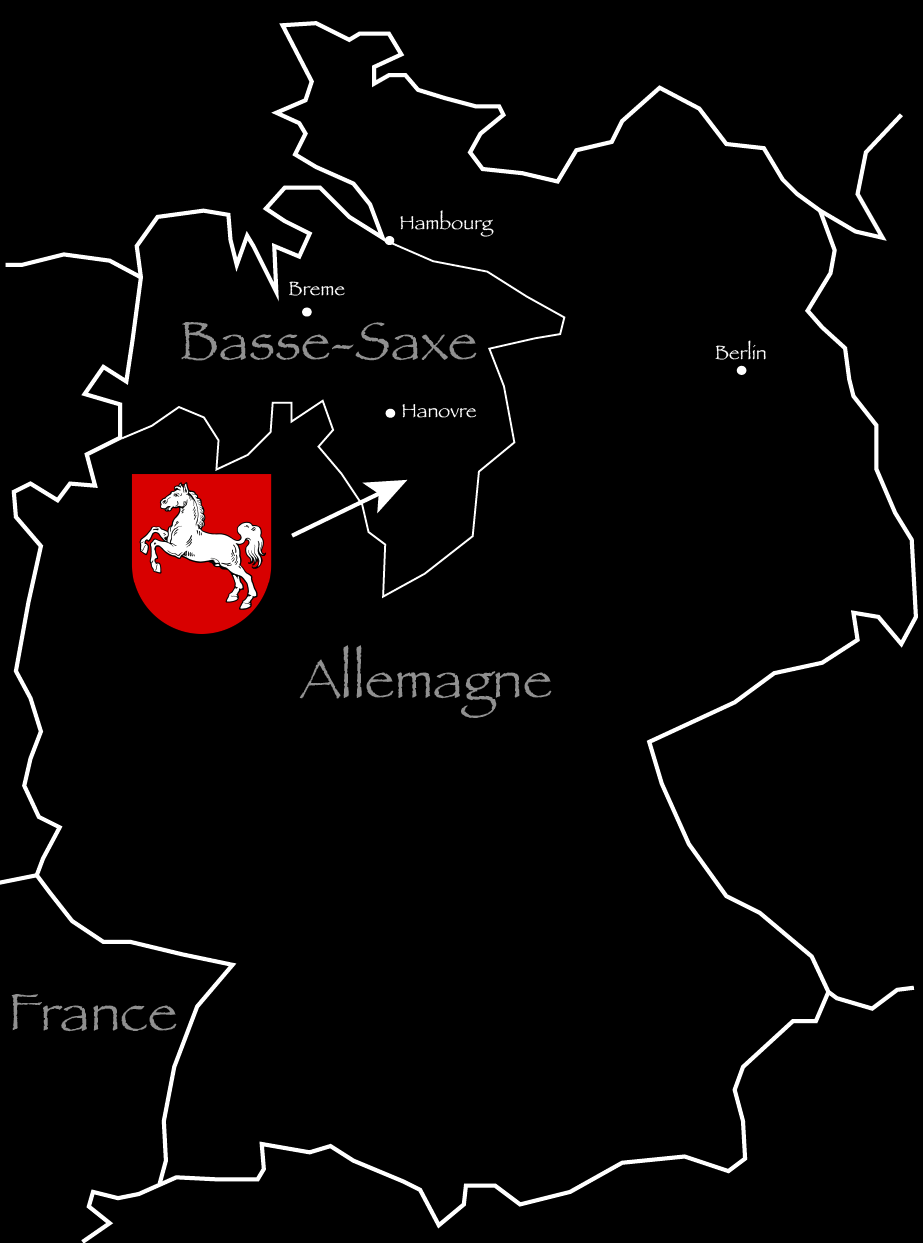Vendredi
4
septembre 1914
1. Le 3e corps rassemble
la 5e et la 6e Divisions d'infanterie.
2. Probablement Le Breuil. Le 28e quitte Le Breuil
pour rejoindre la Ville-sous-Orbais.
|
Vers
minuit, réveil par le canon, les mitrailleuses, les coups de
fusil ; le bruit du canon moins beau. Les mitrailleuses, une
pétarade rapide, brutale et qui donne
l’idée du
délire et de l’irresponsabilité ; les
coups de
fusils, forts et pressés accompagnés de cris, de
chants,
tantôt clairs, tantôt embrouillés, et du
vagissement
soudain de cette trompette prussienne dont un camarade dit :
«
C’est la Mort ! ».
Mais enfin
le
tout, sans
doute à cause de la fatigue, sans grandeur, morose,
mécanique, bête, comme un bouillonnement de
chaudière ; sauf les cris et la trompette qui y mettaient du
barbare ; et enfin de telle sorte que ça ne nous
empêcha
pas de dormir.
C’était
le
passage, dit-on le lendemain, de ce pont de Dormans qui finalement
n’a pas sauté. Et qui sauta, et dont nous ne
sûmes
plus rien.
Avant
l’aube, nous
repartons par les bois, mais recevons ordre de revenir dans les vignes
et d’y faire des tranchées. Pas de pelle,
naturellement.
Avec deux fagots et des échalas, je me retranche, et
Levasseur
et moi nous dormons sur la paille.
Une aube
vient,
violette, grise, où le soleil est enfumé,
saluée
par le canon. Sur le versant gauche, des camarades bleus se glissent
entre les vignes, avancent, puis reculent. Ça ne semble pas
réel. Sur le versant droit, village éteint. Au
fond,
fumée.
Après
quelques
coups de canon, sans tirer, nous repartons. Encore les bois, les
sentiers, la fatigue. Nous nous reformons près de la ferme
et
tandis que les officiers disaient au soir que chacun resterait sur ses
positions, nous reprenons le chemin de la veille. Encore la fuite ?
Encore la route entre les grands peupliers, les chevaux morts, des
colchiques, les sacs éventrés, la peine. La
fatigue, la
chaleur, la honte, les plaisanteries des camarades (on rit de sa
misère, disaient-ils ; mais est-ce rire que
d’annoncer la
prise de Paris avec cette certitude ?) me firent un chagrin
à
éclater. Ce fut le matin de la destruction du
cœur. Car
d’une part cette folie de l’homme
(malgré la
symphonie admirable des obus !) d’autre part la
défaite
possible de la France (encore que oui ! ce n’est bien que la
débâcle du troisième corps (1))
m’accablent. Et
tête baissée, marchant dans mes seuls pas, les
larmes aux
yeux, le cœur contracté par une impitoyable main,
je ne
puis plus même lire les poteaux indicateurs, et je suis
pareil
à un homme mort.
Nous
quittons la
route
pour entrer dans les bois, et nous marchons sans arrêt. Nous
allons être coupés ! dit un lieutenant. Compagnies
et
régiments confondus, horribles chemins à
fondrières, à boue, à suintements
horribles. Et
rien à boire dans ce marais, mourant de soif. Quelques
mûres, et la consolation de quelques houppes
légères de bruyère.
Épuisement,
harassement, coups de canon, mais ça nous est bien
égal !
Halte couchée dans ces bois surchauffés ; pas
d’eau
à cette traîtresse petite maison !
Ha,
qu’il faut
chaud ! qu’il fait triste !
Traversé
un
village inconnu (2) ; le canon nous poursuit de cette longue
crête.
Puis ce long val, toujours les obus au-dessus de nous, leur tracas
final, non pas leur chant ; mais rien n’importe à
l’homme exténué. |
|

La route venant de l'Huis et descendant vers Le Breuil. Photo : V. Le Calvez (avril 2014).

Le "long val" dont parle Thierry est certainement la vallée du Surmelun (ruisseau).
Selon certains rapports de compagnie, le 28e passe le ruisseau à la hauteur de La Ville-sous-Orbais.
Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

Le carrefour de la Ville-sous-Orbais : chemin des troupes qui sont montés sur le plateau des Thomassets.
Photo : V. Le Calvez (avril 2014)
|
|
|
3. S'agit-il de la ferme des Thomassets ?
4. Le lieutenant Noblesse
est lieutenant à la 5e compagnie du 28e RI.
Il sera évacué pour maladie en octobre 1914.
|
Au long
d’un petit
bois, croyant tomber, je me jette mon quart d’eau
à la
figure ; ranimé ou à peu près,
j’atteins la
grand’halte : une heure sous un affreux soleil. Obus sur
nous.
Nous montons la crête, nous nous couchons, nous gagnons une
meule
près d’une ferme (3), repos !
– un bois plus
loin, repos
!
A peine
tapis dans
ce
bois, nous recevons l’ordre de contre-attaquer. Nous
ravançons ; joli bois taillis, petit hêtres,
petits
chênes et broussailles ; couchés un instant,
complétés par l’autre demi-section, le
lieutenant
Noblesse (4)
(instituteur,
paraît-il, et
sous-lieutenant qui dormait
fort bien au bruit de la mitrailleuse, comme cet autre Alexandre !)
nous fait déployer.
Enfin voici
le
champ de
bataille ! enfin voici la ligne de feu !
Nous pas le
calme,
mais
la joie ; une certaine joie excitée et ivre…
Le champ,
c’est un
immense rectangle gondolé ; le soleil derrière
nous sur
la gauche ; il est environ trois heures. A gauche une crête
et un
bois. En avant, loin, une crête descendante, grise, entre un
bois
et la même ferme. A droite, le baisier du coteau, et plus
loin
les bois du matin.
 L"immense rectangle gondolé" du plateau des Thomassets.
L"immense rectangle gondolé" du plateau des Thomassets.
Photo : V. Le Calvez (avril 2014)
Une route
longitudinale
avec de petits arbres, une route transversale, le long de la ferme, des
piquets avec de la ronce, deux haies, deux fossés
transverses.
Des vaches dans le pré à gauche. Des soldats
formant
chaîne à chaque plissement. Le canon
derrière et
devant formant dans l’air de petits nuages.
En avant !
La
bataille
n’est rien de visible, mais du fracas. Le canon bourre le
ciel.
On sent comme dans l’orage d’énormes
ballots
d’air comprimé qui se rencontrent. Les
balles…
d’abord je n’ai pas entendu les balles, mais
j’ai
cru, oui vraiment, que des oiseaux effrayés par la mitraille
s’envolaient près de moi avec un petit piottement. |
|
|
5. Est-ce le commandant Denvignes,
chef de bataillon du 24e RI qui a remplacé le colonel Allier
le
30 août 1914.
Selon le JMO, un seul commandant
a été blessé ce jour : Denvignes.
6. Il s'agit probablement de Suzanne Jacoulet,
sa fiancée depuis juillet 1914.
|
En avant !
un bond
!
Voici le premier blessé ; un des nôtres, portant
à
hauteur du cœur sa main noueuse toute rouge d’un
sang lie
de vin. Il dit : « Ce n’est rien ». En
effet, ce
n’est rien. C’est le baptême du premier
blessé. J’ai le cœur si tranquille que
j’en
suis surpris et presque scandalisé par la dureté
qu’il y a certainement dans le cœur
stoïque.
Avancement,
déploiement. Nous nous couchons, mais nous ne tirons pas car
nous avons des camarades devant nous.
C’est
au
deuxième fossé seulement que j’eus
cette intuition
que ces oiseaux c’était des balles ; cette
naïveté me réjouit
jusqu’à sourire.
Mais je ne puis pas dire combien j’étais content
de
retrouver en moi-même, aussi simplement, aussi tranquillement
le
sang des batailleurs ou plutôt celui des mainteneurs et des
fidèles au poste.
Au
fossé, on cria
: en retraite ! Les soldats couraient par chaîne
disloquée, les blessés s’en allaient
clopinant par
la route, une vache tuée dormait sur le flanc, les autres
écoutaient, fanon tendu, ce grand ravage.
Au premier
fossé,
un commandant (5)
nous
arrêta qui criait
d’une voie
enrouée : « En avant ! ils ne sont pas cinquante !
»
Debout sur un cheval rouge, agitant son épée, une
balle
dans le menton lui faisait un trou rouge…
«
R’en avant
! criait-il, R’en avant ! » J’avance sans
me courber
dans les éclats d’obus et dans les balles, sans un
atome
de peur, sans un seul baissement de tête, mais aussi sans
nulle
excitation ; même pas, du moins je le crois, même
pas de
l’orgueil. (Je me suis demandé si le danger
visible me
laisserait aussi tranquille ; mais comment le savoir ? »).
Arrivée
à
la ligne du feu près de la levée de terre, une
haie
légère, quelques arbres ; abritée par
un de ces
arbres, hausses à 300, objectif le coin du bois et le
poirier,
je tire mes premières cartouches, sans joie, avec joie,
enfin
parce que : qu’est-ce que j’aurais fait ? Un bond !
et nous
tirons sur la deuxième ligne. A ma gauche un bon petit
caporal
à la figure innocente. Il tire. Je le regarde, car les
coudes me
font déjà mal. Soudain, il dit : « Je
suis
touché », et sans bouger regarde son
épaule gauche.
Il se tait ; il n’ose respirer. Puis il lâche son
fusil, se
retourne un peu sur le flanc, fait le signe de la croix et dit bien
doucement : « Dieu me bénisse ! » Puis
il joint ses
petits poings sous sa petite épaule, et il baisse le front
ayant
l’air de s’endormir.
Comme il ne
bouge
pas,
je me demande s’il n’est blessé que de
peur.
Un bond !
nous
voici sur
une ligne qui va d’une meule à la ferme. Le
commandant est
à cette meule, debout sur son cheval ; il saigne toujours,
il
crie toujours, il n’a plus de voix. Cette fois, je vois bien
l’ennemi, ombres défilées et
déployées et je lui tire dessus, mais pas vite
car les
coudes me font mal et je ne puis pas élever mon fusil. Je
passe
des cartouches à gauche et à droite. Mes deux
voisins et
moi nous tiraillons, bien tranquillement. Ils ont mis leur sac devant
leur tête, j’ai gardé le mien au dos.
Une balle
frappe
la
gamelle du voisin de gauche et dévie ; une autre me siffle
de si
près à l’oreille que je me dis avec un
sourire :
ô S. (6), en voici une qui
a passé
bien près de ce
visage chéri ! Mais soudain le voisin de gauche pousse un
cri.
Il se prend l’épaule à deux mains et
crie : oh !
puis il crache un peu de sang. « Sergent, dis-je à
son
voisin, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il
élève
les sourcils et dit : Déshabillez-vous. Le pauvre
garçon
ouvre sa capote, son ceinturon, son pantalon. Mais une convulsion le
plie en arrière. Un sang glaireux lui sort de plus en plus
abondant de la bouche. Il crie d’une grande voix
étouffée : « Adieu, les
a…mis ! adieu les
a… ! » Je me glisse auprès de lui et je
serre le
bout de ses doigts sanglants. Mais déjà il
ramène
sa main contre sa bouche, et par ses lèvres, par le nez
aussi,
il rend tout son sang contre la crosse de son fusil. Il a une figure
allongée, rouge, un nez de buveur ; le sang rend ses traits
horribles et paisibles. Il penche le front et ne bouge plus.
Alors je
sentis
dans
l’épaule un coup de poing très fort et
très
pointu, suivi d’un arrachement de vrille qui me donne
là
même convulsion qu’au camarade.
J’attendis un
moment pour voir si le sang allait venir. Comme non, je dis
à
mon voisin : « Je suis blessé. – Va te
faire panser
à la ferme, me dit-il, vas-y
en rampant.
» Cependant
je ne sentais aucun mal et j’étais très
surpris. Je
respirais sans douleur et je songeais que si j’avais
défait mon sac, comme les voisins, j’aurais
assurément eu le poumon traversé.
Sac,
(pauvre cher
vieux
raseur ! pensai-je), musette, fusil, ceinturon, je laissai tout
ça et m’en allai tout droit. Au fossé,
je tombe, je
roule et je reste là mordant un peu l’herbe.
Cependant, le
canon, les petits nuages blancs, les balles et les blessés
qui
s’en allaient si tristes… Mon Dieu, comme
j’en avais
assez de l’homme ! et en même temps,
blessé pour
blessé, comme j’étais content que ce
fut à
cet inutile bras gauche ! Relevé, je fais quelques pas, pas
vite, et tournant l’angle de la ferme, je tombe dans le
charnier,
car on y pansait, et dans l’oasis car les balles
n’y
tombaient plus, et la paix y était fraîche comme
de
l’ombre.
On pansait,
mais
le
sergent me fit entrer dans la ferme, une sorte de hangar plein
d’hommes sanglants et de paille. L’infirmier
s’occupa
de moi tout de suite, et me pansa délicatement. A cause du
sang
perdu, je faiblis un peu sur les genoux et je vis beaucoup de brume, en
même temps un grand froid. Mais ça passa.
 La ferme des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)
La ferme des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)
A peine
assis
contre le
mur à côté d’un autre bras
sanglant, les
Allemands avec un grand piétinement entrèrent
dans la
cour : « Plessés ! Plessés
!… Ceux qui ont
des mains lèvent les mains. Ils trouvent quelques fusils
qu’ils brisent par la crosse avec des mines terribles. Puis
on
entend un coup de fusil ; un Français sort d’un
coin
d’écurie : ils visent à trois, debout ;
ils tirent,
il tombe.
Dès
lors, je
commence de parler allemand avec eux et ils nous donnèrent
tout
ce que je leur demandais : notamment un pauvre misérable
blessé au ventre qui demandait en gémissant du
lait, de
l’eau, une brique chaude, de la paille, une capote, un
matelas !
Un
officier, le
capitaine, accourut en jouant de la cravache. Il cria dans un
français grotesque : « Messieurs les prisonniers
qui
peuvent marcher, levez-vous, où je vous tue ! »
Mais il se
radoucit dès qu’on lui eût
parlé de moi,
quoique me disant que nous portions la responsabilité de la
guerre.
Les
blessés
geignaient et saignaient. Un certain nombre d’Allemands, mais
la
grande majorité de Français. Maintenant
j’étais couché dans la paille. Un
sergent à
ma gauche râlait déjà. Et les Allemands
vivants
traquaient les poules, faisaient du feu, gobaient les œufs
(l’un deux m’en donna un) et pillaient la cave. |